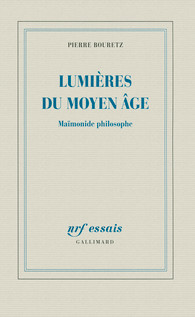Essai d’histoire du droit romain par Derek Roebuck et Bruno de Loynes de Fumichon.
Une énorme partie de la résolution des disputes dans l’Etat romain (République et Empire, y compris dans à Byzance au début du Moyen-Âge, qui sont les ères et les aires ici considérées) n’est pas le fait de tribunaux institutionnels mais d’arbitrages par un citoyen (ou parfois plusieurs) désigné par les deux parties en conflit. Ces arbitrages avaient plusieurs avantages (tout en étant limité au civil) : il n’y avait pas vraiment de perdant pouvant encourir l’infamie comme c’est le cas lors d’un procès (p. 152) et les parties décidaient de la procédure dans le contrat passé entre eux et l’arbitre, dans les limites de la loi. Il y était plus question d’équité, sans la sanction d’un procès où toute erreur de présentation se soldait par l’infamie. Mais comme ces procédures, qui parfois s’appuient sur la puissance publique au travers du préteur, sont essentiellement privées, les documents de première main sont assez rares et les auteurs du présent livre (Derek Roebuck est l’auteur de toute une série d’ouvrages sur l’arbitrage tout en étant professeur de droit comme le second auteur) eurent aussi à considérer un large éventail de sources.
Cet ouvrage est divisé en douze chapitres, que l’on peut répartir en trois parties. La première de ces parties est une mise en contexte, avec un prologue centré sur un papyrus découvert en Egypte, écrit en grec mais suivant le droit romain, celui d’un arbitrage rendu par Dioscoros d’Aphrodite, juriste et poète. Il montre la persistance au VIe siècle du droit romain dans une Egypte faisant partie de l’empire byzantin. Le second chapitre cherche à mettre au clair différents termes (arbitre, juge, etc.) tout en insistant sur les difficultés de traductions des textes anciens. Avant de passer aux sources elles-mêmes, les auteurs font un détour dans le troisième chapitre par l’histoire de Rome, ses institutions et la naissance de son système judiciaire tout comme les transformations de ce dernier avec la christianisation de l’empire. Clôturant cette première partie, les auteurs présentent leurs sources, avec au premier rang d’icelles le Code de Justinien, mais touchant aussi aux domaines littéraires ou techniques (architecture, arpentage), transmises par la tradition ou trouvées sur à des fouilles archéologiques.
La seconde partie est celle décrivant deux types d’arbitrages en usage à Rome, celui par bonus vir et celui dit judex arbiterve. L’arbitrage dit de bonus vir (que l’on peut traduire par bonhomme, où citoyen de bonne réputation et bonnes mœurs p. 51) n’est pas juste une médiation mais n’a pas l’appui de l’Etat. L’arbitre est choisi par les parties (il est un ami des deux parties), mais sans l’assentiment du préteur (ou tout officiel romain reprenant son rôle de direction du système judiciaire dans la province ou le municipium). Cependant, sa décision est susceptible d’appel à Rome. Signe de son caractère commun, l’arbitrage par bonus vir a son abréviation officielle avant le premier siècle de notre ère (p. 64). Le second type d’arbitrage décrit dans cette partie est celui dit judex arbiterve. A la différence du bonus vir, l’arbitre est choisi par le préteur dans une liste d’hommes qualifiés (l’album), mais avec une procédure fixe (découlant de l’édit du préteur). Mais si les parties n’étaient pas d’accord avec le choix du préteur il leur restait toujours le choix de revenir à une procédure privée.
Et la reine de ces procédures privées, c’est celle de l’arbitrage ex compromisso (troisième et dernière partie, les chapitres sept à douze). Les auteurs procèdent avec méthode et profondeur dans ces six chapitres, abordant tout d’abord les origines de ce type d’arbitrage, le rôle du préteur (qui ne choisit par l’arbitre mais apporte caution et soutien dans la résolution la plus rapide possible du conflit) et les objets de conflits. Puis les auteurs s’intéressent au compromis entre les parties et l’arbitre dans le chapitre suivant, à qui peut être arbitre (tenu par le contrat et l’obligation de rendre une décision, mais aussi tenu par les lois et sa morale et celle de la société, p. 57) et quand le citoyen cesse de l’être. L’audience est l’objet du dixième chapitre, avec ses limites, la place des preuves et des témoins (l’arbitre ne peut convoquer des témoins, p. 160 et p. 167, à la différence du judex), sa publicité, les recours contre la fraude (l’arbitre ne reçoit aucune rémunération d’aucune sorte comme un magistrat, pas même si les deux parties se trouvaient ici aussi à égalité, p. 77), la langue employée (cela peut se faire dans n’importe quelle langue, p. 167) et les serments (surtout pour la période paléochrétienne). Après l’audience, qui n’est pas un procès (p. 162-163), l’arbitre doit rendre sa décision (c’est le onzième chapitre). Les auteurs s’intéressent à sa portée, aux éventuels appels, à sa forme mais évoquent aussi les cas particuliers de sentences impériales (puisque bien entendu, le prince peut aussi être arbitre).
Le dernier chapitre est celui de la conclusion et de l’épilogue. La conclusion revient par exemple sur la différence entre la loi et l’équité (la loi et les formules rigides à l’inverse de l’équité et de la recherche de la paix dans l’arbitrage dont on rappelle qu’il ne concerne pas les crimes). Procope, contemporain de Justinien, y est cité avec beaucoup d’intérêt (p. 195-198), avant que les auteurs ne concluent leur ouvrage sur les similarités et les différences avec la pratique actuelle de l’arbitrage (l’arbitrage moderne prohibe le lien avec les parties mais autorise par contre les accords qui concerne des désaccords futurs, p. 6, p.11 et p.201).
Le volume est augmenté d’un répertoire des sources (seules les sources latines sont reproduites), d’une chronologie, d’une bibliographie et enfin d’un mix entre un index et un glossaire.
Il y avait bien longtemps que l’on avait pas lu un livre sur le droit romain, et le plaisir a de nouveau été au rendez-vous. Les auteurs sont peut-être un brin trop critiques en ce qui concerne les sources de la Rome royale et de son droit (p. 23) et ces mêmes auteurs restent aussi des juristes. Cela se voit dans certaines imprécisions (pour ceux qui se souviennent du manuel néanmoins classique de Michel Humbert, cité parmi les grandes influences des auteurs p. XI …) : le « parti » des optimates, la différence entre pérégrins et non-citoyens (p. 25), le christianisme comme religion officielle sous Constantin (p. 27), l’édit de Caracalla en 212 ap. J.-C. (p. 164), par exemple, sont des notions assez survolées. Et quand on parle de Vitruve comme architecte de Jules César (p. 43 et p. 86) ou de, meilleur encore, « citoyenneté féminine » (p. 25), les sourcils se haussent beaucoup … De même, le résumé d’histoire romaine (p. 24-25) est assez baroque. Pour en finir avec les points noirs, le système de citation plaçant un mot latin traduisant un mot placé devant lui après une virgule n’est pas des plus plaisant (ni même sans doute efficace).
Dès que l’on passe à l’analyse des textes, on revient en pays connu. C’est très structuré (même si cela pourrait être plus long sur le judex arbiterve), clair et avec la volonté de porter la lumière sur tous les aspects de la question. Les sources non judiciaires sont bien utilisées (Pline le Jeune comme arbitre bonus vir, p. 63, voir un peu de truculence avec Aulu-Gelle p. 68-69 comme judex) et l’épigraphie n’est pas non plus laissée de côté. Le tout se lit assez facilement dans un anglais qui ne cherche pas les effets de manche, grâce aux bases bien posées au niveau lexical au début de l’ouvrage qui font ce livre très accessible aux non-spécialistes.
La qualité générale de l’ouvrage encourage donc à aller voir les autres livres sur l’arbitrage de Derek Roebuck, en espérant que les parties historiques soient un peu meilleures …
(d’être arbitre, on ne peut être délivré presque que par la mort, l’insolvabilité ou par la prononciation de la décision … 6,5)