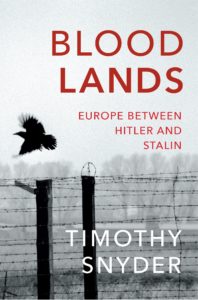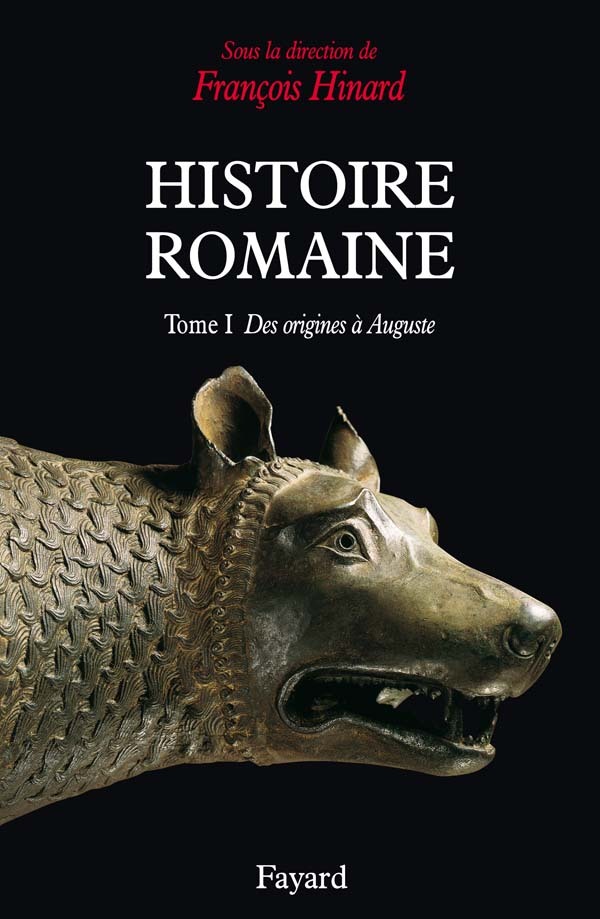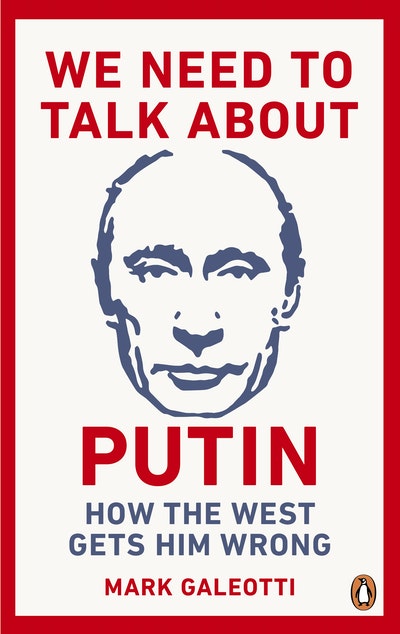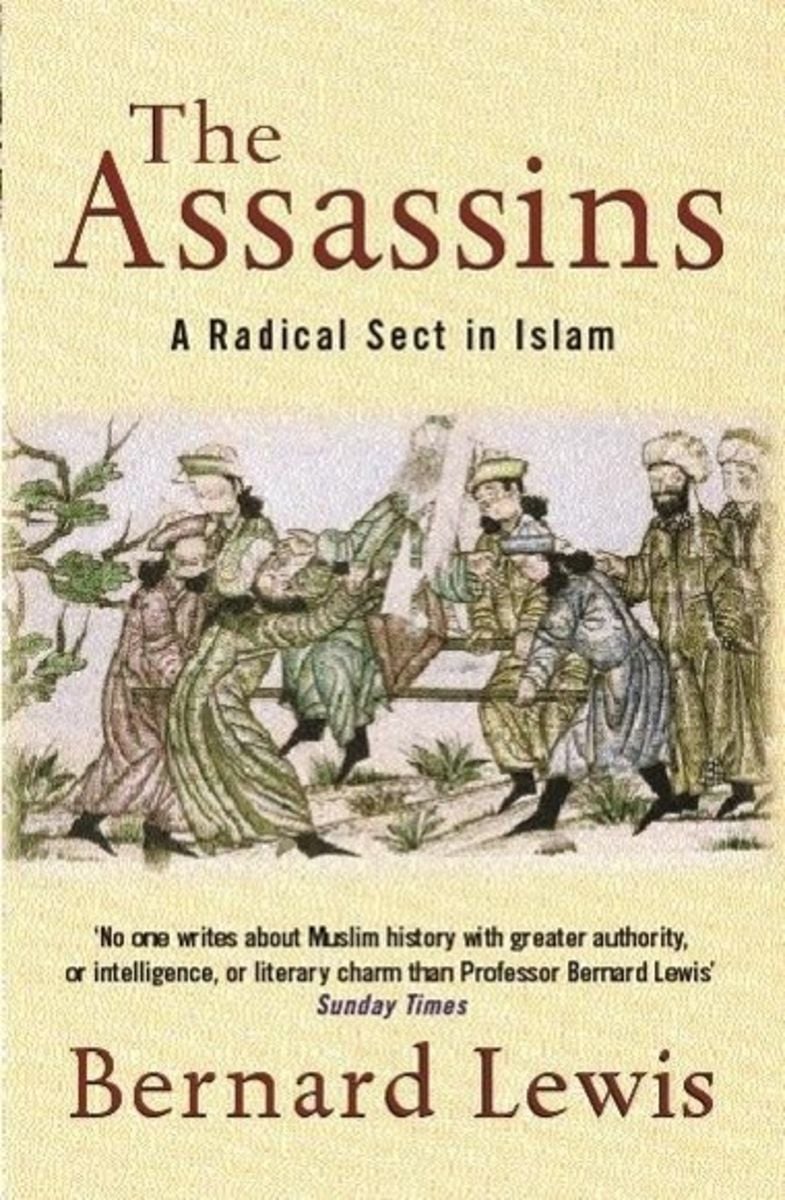Essai historique et historiographique sur la Grande Révolution de François Furet.
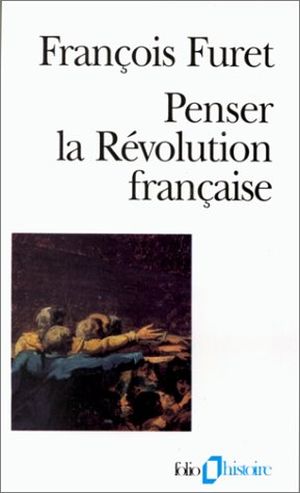
Juste après la Seconde Guerre Mondiale, la révolution de 1789 est la référence la plus utilisée dans le débat public en France au XXIe siècle. Est-il beaucoup d’autres pays où un homme politique du XVIIIe siècle est encore un modèle ? En France c’est pourtant le cas avec Robespierre. F. Furet est des modernistes qui ont animé le débat historique dans la seconde moitié du XXe siècle sur cette (courte) période. Il détonne dans le paysage historiographique parce que sans être anti-révolutionnaire, il n’est pas pour autant de la veine communiste (courant dominant à l’Université après-guerre). Le communisme, il a rompu avec lui en 1959 et donc est une cible toute désignée pour des chercheurs comme A. Soboul et ses épigones auxquels il conteste l’idée d’une révolution bolchevique déjà programmée dans les évènements se déroulant entre 1789 et 1793.
Le livre est composée de quatre parties, à rebours de la chronologie. La première partie est une synthèse sur l’historiographie de la Révolution de 1789. F. Furet y considère 1789 du point de vue d’un mythe des origines, dont l’histoire qui en est faite a pour but de maintenir chez beaucoup d’auteurs l’unité et la pureté (le texte date de 1977), mais il consacre aussi de nombreuses pages aux combats de la fin du XIXe siècle entre républicains et royalistes, attaque les marxistes en démontrant la pluralité de vues du même Marx sur la Révolution et détaille la place singulière qu’occupe Tocqueville et son ouvrage L’Ancien Régime et la Révolution en tant que premier intellectuel a avoir pensé la continuité entre monarchie et république. Autre jalon historiographique d’importance pour l’auteur, l’archiviste Augustin Cochin veut lui comprendre le jacobinisme, mais sans s’en réclamer. Au début du XXe siècle, et plus encore après la Première Guerre Mondiale (à laquelle il n’a pas survécu), c’est s’attirer beaucoup de critiques. A. Cochin a aussi étudié les cahiers de doléances du début de l’année 1789, conduisant à casser le grand mouvement téléologique de la Révolution (et qui nous semble encore enseigné aujourd’hui …).
Pour F. Furet, et c’est l’objet du quatrième chapitre de la synthèse, le fait décisif permettant le Révolution est la vacance du pouvoir qu’il fait remonter à 1787. Les bureaux de Versailles n’ont plus les choses en main, les classes dirigeantes sont divisées (Assemblée des Notables), et pour couronner le tout, des élections ont lieu pour les Etats Généraux en lieu et places des traditionnelles désignations au sein des différents groupes considérés. De tout ceci ne sort pas un pouvoir bureaucratique mais celui du verbe, lui même en proie au soupçon. Le complotisme nourrit cette période saturée de politique, conduisant à des vagues d’épuration au sein des Assemblées (jusqu’à la Terreur) et ceux qui pensent arrêter la Révolution (à leur profit en général) sont successivement balayés. Ce qui amène l’auteur au jacobinisme et à Robespierre, aux oligarchies militantes (p. 122) et à la disparition progressive du peuple des décisions politiques qui aboutit à Thermidor. Ici s’achève pour F. Furet la révolution, quand la légalité remplace la légitimité.
Dans la seconde partie du livre sont rassemblés trois articles qui à partir du début des années 1970 ont conduit à la rédaction de la synthèse. Le premier de ces articles est une réponse à la critique soboulienne qui a été fait du manuel co-écrit avec D. Richet et paru en 1965-1966. C’est l’occasion, dans un style assez offensif et jubilatoire, de retourner la pareille. L’auteur y discute de méthodologie mais combat aussi sur le plan des faits : existe-t-il encore, par exemple, une féodalité en 1789 ? Peut-on parler d’aristocratie ou de classes dominantes ? Dans un second article, F. Furet discute en profondeur de la vision de Tocqueville développée dans son livre paru en 1856 sur l’Ancien Régime. La différence entre aristocratie et noblesse est justement déjà un sujet traité par l’auteur normand. Enfin un troisième et dernier article, faisant monter l’ensemble du livre à 310 pages, est consacré à Augustin Cochin, archiviste et historien, que l’environnement familial bourgeois n’a pas préparé à devenir un théoricien du jacobinisme. F. Furet décrit les influences de A. Cochin (Durkheim), son cheminement et les difficultés qu’il rencontre. Il discute ensuite les idées de A. Cochin sur les « sociétés de pensée » qui donneront naissance aux clubs jacobins et comment ceux-ci vont se figurer être le porte-voix du Peuple où l’opinion devient action (p. 291).
Ce livre est d’un format intéressant, avec finalement des redites assez peu nombreuses dans ce cheminement intellectuel sur plusieurs années. Au niveau des idées, au-delà d’une présentation impeccable des faits, on sent une affinité avec le courant que représente aujourd’hui M. Gauchet, dans la recherche de l’Un par les révolutionnaires à la suite du roi ou sur la prise de conscience que l’Homme peut agir sur le monde (p. 44). La description de la paralysie et de l’aventurisme au sommet de l’État est remarquable (p. 172-174, l’absolutisme détruisant la société à ordres), tout comme la perpétuelle épuration des révolutionnaires nourrie au complotisme le plus effréné, jusqu’à la séparation de la société et de la politique qu’a été Thermidor (p. 119). Il faut aussi sortir du lot la description des trois types de noblesses qui auraient pu se former au XVIIIe siècle (anglaise, prussienne et polonaise, p. 179) mais surtout que la révolution a peut-être déjà eu lieu en 1787, avec la prise de pouvoirs des « patriotes » dans les sociétés de pensée (p. 287-295). La politique, élevée au rang de religion, n’encourage pas au compromis, à l’intérieur comme à l’extérieur et l’auteur est clairement un partisan de la guerre comme conséquence de la radicalisation que l’inverse.
Il va sans dire qu’une connaissance superficielle de la période n’aide pas beaucoup à la lecture de ce livre, mais le plan où ce situe l’analyse est assez élevée, une connaissance au jour le jour dans les moindres recoins idéologiques n’est pas requise. Toujours intéressant, parfois jouissif et le plus souvent agréable à lire, un bon appel à remise à niveau !
(au XVIIIe siècle triomphe l’idée des libertés germaniques comme fondement de la France contre l’héritage romano-byzantin p. 61 … 8)