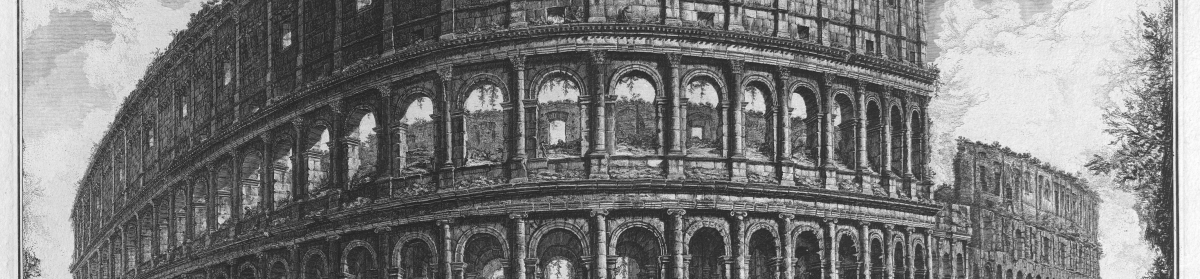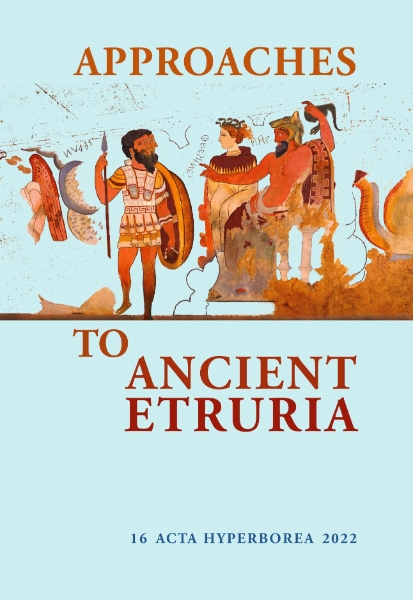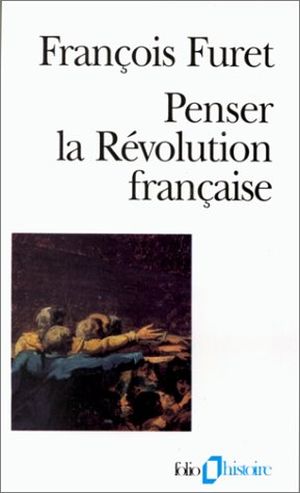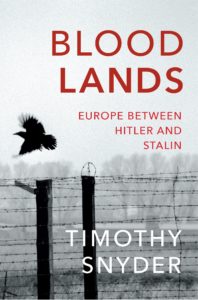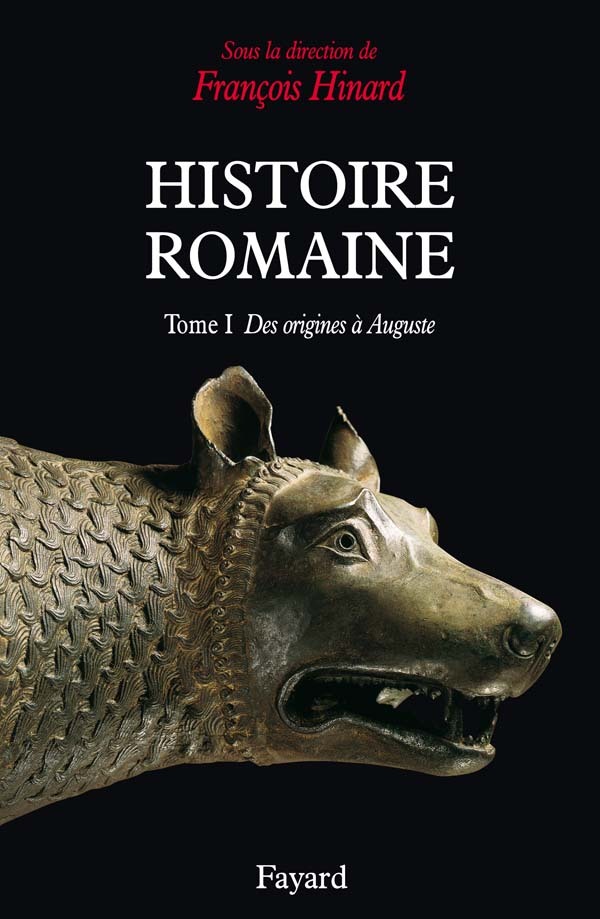Russia’s super mafia
Essai historique sur le monde criminel impérial, soviétique et russe de Mark Galeotti.
Trois catégories de personnes étaient prêtes à agir et à prendre possession des entreprises que le gouvernement russe privatisait au début des années 1990 : les fonctionnaires dirigeant ces entreprises, des membres de l’appareil de sécurité et la pègre. Celle-ci ne venait pas d’apparaître avec la fin du régime communiste. Les prisons et les camps de l’URSS n’étaient pas peuplés que de dissidents, très loin de là. Et par un heureux hasard, tous ces gens sont justement, à divers niveaux et de différentes manières, en contact. Mark Galeotti a pu observer cette prédation à Moscou même, après avoir été mis en contact avec ce monde grâce à sa thèse sur les anciens combattants d’Afghanistan qu’il complétait à la fin des années 1980. Ce livre, paru en 2018, est le fruit de trois décennies d’entretiens, d’observation et de travail historique.
Passé la petite introduction, l’auteur attaque direct avec les fondations du monde criminel russe à la fin du XIXe siècle, entre vol de chevaux dans les campagnes (et justice paysanne expéditive afférente) et l’exode rural qui fait des grandes villes russes de gigantesques bidonvilles, où la police corrompue est plus un danger qu’une aide et vouée à la protection des classes les plus aisées. De cet environnement propice naissent des gangs, développant une sous-culture à part.
La révolution de 1917 change peu de choses au monde de la pègre (à part que tout le monde est libéré de prison … p. 39-40) et la guerre civile qui fait rage entre 1918 et 1922 voit l’utilisation des ressources de grands criminels de chaque côté. La tranquillité publique est aléatoire et il y a 7 millions d’enfants dans les rues. Lénine lui-même se fait racketter. Avec la victoire des bolcheviques et l’arrivée au pouvoir de Staline, l’État reprend les choses en main, à sa façon. Le goulag se remplit (au moins 28 millions de prisonniers pendant la période stalinienne p. 43), et pas que d’innocents, ce qui a pour conséquence une uniformisation de la culture criminelle à la faveur des déplacements. L’administration des camps utilise aussi les criminels pour mater et contrôler les autres détenus. Il y a là la première cassure dans le monde criminel, entre ceux qui veulent bien collaborer avec l’État si c’est à leur propre profit (au point de diriger des camps) et ceux, ancien style, qui refusent tout ce qui vient de l’État, y compris l’ordre de travailler. Certains de ces derniers sont prêts à mourir pour ne pas travailler. A tuer aussi. Le fossé s’élargit avec l’invasion allemande, entre ceux qui combattent (volontaires ou forcés) et les autres et une guerre entre les deux groupe fait rage. Aidés par l’État, les collaborateurs l’emportent sur les traditionalistes après 1945.
La mort de Staline a pour conséquence l’élargissement de beaucoup de prisonniers, surtout parce que le goulag n’est économiquement plus viable avec le chaos qu’a engendré le conflit interne (p. 59-60). Hors du camp, la collaboration entre criminels et fonctionnaires corrompus va se poursuivre et les hors-la-loi seront les premiers à profiter de tout desserrement du contrôle soviétique, y compris des tentatives de réforme des années 1980, mais aussi de la prohibition (p. 99). Les voleurs deviennent les intermédiaires pour tout. La décennie 1990 voit une nouvelle recomposition, profitant de l’éclipse de l’État redevenu russe et l’accaparement, l’extorsion et le meurtre sont choses très courantes jusqu’à que le marché se stabilise avec le retour d’un Etat fort mais pas forcément vertueux à l’aube du nouveau millénaire. Mais la stabilité du monde criminel empêche l’ascension sociale en son sein …
M. Galeotti continue son exposé avec la description du paysage criminel russe (même si le qualificatif de russe est longuement discuté dans le livre), en les classant selon les types d’organisation (p. 129). Sont présents les Tchétchènes (mais c’est aussi un label p. 163), les Géorgiens et ceux qui qui ont développé des connexions en Asie. Enfin l’auteur défriche quelques évolutions possibles entre numérisation du crime, contournement des sanctions économiques visant la Russie (produits technologiques mais aussi fromages) mais aussi la manière dont le gouvernement russe utilise la pègre (Crimée, Donbass) et comment la sous-culture criminelle (en voie d’européanisation?) percole dans la langue russe (à travers la chanson en premier lieu). Suivent un glossaire, les notes, la bibliographie et un index.
Voilà une bonne rencontre historico-anthropologique, avec une profondeur et un soubassement théorique que M. Galeotti ne peut pas montrer dans ses nombreuses interventions médiatiques depuis février 2022 ou dans son livre plus journalistique sur Poutine. On voit assez vite que le processus d’écriture a été bien plus long … Solide documentation primaire et secondaire tout d’abord, mais très utilement complétée par des entretiens que l’auteur a eus dès les années 1980, tout d’abord avec les vétérans d’Afghanistan puis de fil en aiguille avec différentes personnes du milieu (à tous niveaux) et des forces de police. Les citations en début de paragraphe reflètent cette richesse des sources. Trente années de conversations au long cours, du moins avec ceux qui ont survécu assez longtemps. Tout cela donne non seulement une très grande profondeur au propos parce que allié à un appareillage théorique emprunté à d’autres sciences humaines, mais aussi un texte très agréable à lire, peut-être avec moins d’esprit que d’autres écrits de M. Galeotti, mais il faut aussi dire que tout ne s’y prête pas non plus. La description de plusieurs mondes, et tous n’ont pas disparu.
(on pouvait être condamné et directeur du camp p. 51 … 8)